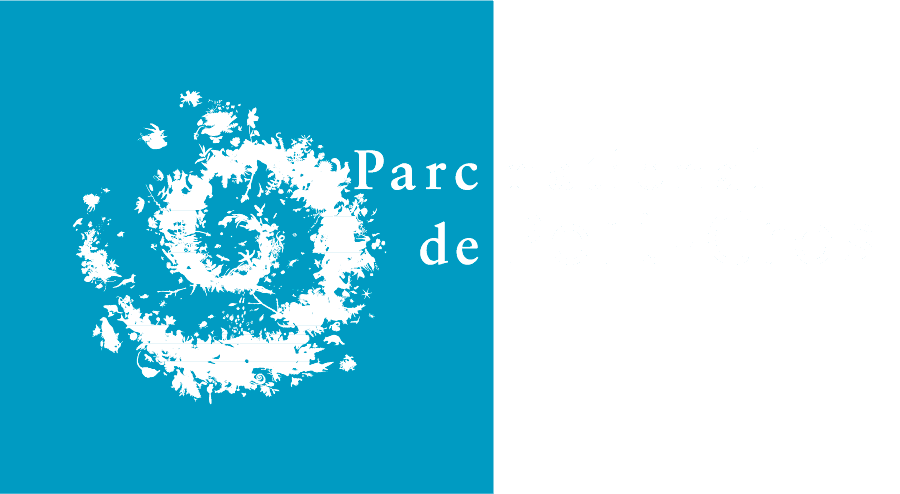Port-Cros - Sentier des plantes

Hyères
Port-Cros - Sentier des plantes
Facile
2h
5,1km
+152m
-152m
Boucle
Embarquer cet élément afin d'y avoir accès hors connexion
Il est conseillé de se procurer la brochure « Sentier des Plantes » (disponible en téléchargement sur le site du Parc national de Port-Cros à l'adresse suivante: http://www.portcros-parcnational.fr/fr/des-decouvertes/une-destination-dexception/des-decouvertes-en-toutes-saisons/sentiers-et-balades-9). Jusqu’à la plage de la Palud, le sentier est rocailleux et escarpé. Le retour est plus facile, par le Vallon noir puis la Route des forts, et permet de découvrir l'intérieur des terres et le patrimoine historique de Port-Cros.
Les 13 patrimoines à découvrir

Armoise arborescente - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 1 - Les plantes venues d'ailleurs
Autour du Fort du Moulin, quelques touffes d’armoise arborescente, reconnaissable à sa couleur argentée et à son odeur aromatique, jalonnent le sentier. Commune au sud du bassin méditerranéen, elle n’est connue en France que dans la rade d’Hyères. Sa localisation près de sites fortifiés est sans doute liée à la présence des Sarrasins qui l’utilisaient pour ses vertus médicinales.
Les palmiers du village (plantés au milieu des années trente), les agaves et les eucalyptus du Manoir ont été choisis pour leur valeur ornementale. Toutes ces plantes retrouvent sur l’île des conditions climatiques proches de leur contrée d’origine : Amérique du Sud pour les agaves, îles Canaries pour les palmiers, Australie pour l’eucalyptus.
Certains de ces végétaux se révèlent être de véritables pestes végétales (par ex. griffes de sorcière, mimosas…) qui concurrencent la flore locale.
Le Parc national veille donc à en limiter l'extension.
Olivier - Jean-Paul Roger Flore terrestreStation 2 - Le cimetière
Le petit cimetière marin est l’un des derniers vestiges de l’ancien emplacement du village. Comme dans tous les cimetières du midi, les cyprès qu’on y trouve symbolisent la vie éternelle et la liaison entre le ciel et la terre.
On peut remarquer, à ce niveau du sentier,
l’abondance des oliviers. Autrefois cultivés puis retournés à l’état sauvage, ils témoignent de la présence passée de cultures autour des habitations. Un peu plus loin sur la droite, une ancienne carrière de schiste, principal matériau de construction de l’île, est encore visible.
Chêne-vert en fleur - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 3 - L'yeuse
Nom poétique du chêne vert, l’yeuse peut revêtir différents aspects. Dans ce vallon humide et sombre, il cherche la lumière et atteint donc une grande taille. Dans le maquis touffu, il prend plutôt la forme d’un arbuste. Bien adapté au climat méditerranéen grâce à ses feuilles très dures et vernissées, il est aussi peu inflammable. La forêt de Port-Cros est en pleine évolution : la population de pins d’Alep, vieillissante, est peu à peu remplacée par les chênes. Si aucun bouleversement n’intervient (déboisement, incendie…) ceux-ci constitueront, à terme, l’essentiel du couvert forestier.
Romarin - Parc national de Port-Cros - LAURENT N. Flore terrestreStation 4 - De la lumière et des parfums
Vers l’ouest, vous pouvez voir l’île de Bagaud, qui est interdite d’accès (réserve intégrale). L’île est battue par les vents et les embruns, le chêne vert en est absent, et le maquis haut y est impénétrable.
Derrière, se profile Porquerolles, plus grande que Port-cros et plus fréquentée.
Avec l’île du Levant à l’Est, les trois îles d’Hyères furent rattachées au continent il y a environ 40 000 ans av. J.C.
Leur insularisation progressive a eu un impact sur la composition végétale qui s’y trouve : certaines espèces sont communes avec le continent comme le romarin, la lavande des îles.
D’autres en sont absentes comme le thym, d’autres encore ne se trouvent que sur les îles ; ces dernières sont dites « endémiques », c’est-à-dire qu’elles n’existent que dans une zone géographique très restreinte. De part et d’autre du sentier, jusqu’à la prochaine station, le sol sec et peu profond, ainsi que l’ensoleillement intense, permettent l’installation de nombreuses plantes héliophiles, qui embaument l’air au plus chaud de l’été : romarin, lavande des îles, ciste de Montpellier, ciste à feuille de sauge, euphorbe characias, asphodèle abondent.
Vous pouvez aussi remarquer un petit
arbrisseau argenté qui ressemble à du thym ; c’est l’herbe aux chats appelée ainsi car son odeur forte provoque chez les chats une excitation intense !
Genévrier de Phénicie couvert de baies non comestibles - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 5 - Pointe du Grand Peyre (grande pierre en provençal)
Ce point de vue permet de découvrir la baie de la Palud et l’îlot du Rascas (dont le nom évoque le dos épineux de la rascasse, poisson des fonds rocheux).
Remarquez le genévrier de Phénicie au-dessus de la plaquette numérotée. Cet arbuste aux minuscules feuilles imbriquées en écailles est caractéristique des lieux les plus chauds et forme des peuplements clairs sur de nombreuses falaises méditerranéennes.
Fleurs de myrte - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 6 - Une nature en trompe l'oeil
Le sentier traverse maintenant et jusqu’à la station 9 une association végétale appelée « oléolentisque » composée principalement par l’oléastre (olivier sauvage) et le lentisque, mais aussi le myrte, les filaires et l’alaterne nerprun.
Par temps calme, les fonds sous-marins forment une mosaïque de couleurs ; les zones bleu-turquoise marquent un fond de sable, les zones sombres l’herbier de posidonie, et les tâches marron les fonds de matte morte (herbier dégradé).
En face, sur les versants dominants la plage, l’épaisse couverture de pins d’Alep est bien visible et domine les sous-bois de chênes verts.
Cet environnement naturel, vierge de tout aménagement, contraste avec les paysages côtiers tout proches. Cet aspect « naturel » est récent : au début du 20ème siècle l’île était à de nombreux endroits entièrement déboisée et cultivée en partie: y étaient exploités vignes, oliviers et maraîchage.
Euphorbes arborescentes en mai/juin - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 7 - Les plantes du soleil
Vous entrez dans une zone qui fut abondamment débroussaillée pendant la seconde guerre mondiale par les armées d’occupation.
Ces éclaircies ont favorisé le venue de nombreuses espèces « héliophiles », (dont certaines sont rares), qui sont éliminées ailleurs par l’ombre de la forêt.
Lumière est ici synonyme de chaleur et sécheresse. Les stratagèmes inventés par les plantes pour survivre à l’été méditerranéen sont multiples.
Les euphorbes arborescentes offrent un bek exemple tout autour de vous : un port en boule qui minimise les pertes par évaporation, des tiges « succulentes », c’est-à-dire charnues, qui stockent des réserves en eau (comme le font les cactus du désert) et l’option originale de perdre tout feuillage avant l’été. Une sorte de vie au ralenti pendant quelques mois.
Autres solutions efficaces pour limiter la transpiration : des feuilles coriaces, imperméables, et/ou munies de poils en dessous, parfois en forme d’aiguilles ou d’écailles. Observez autour de vous.
Arbousier - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 8 - Le maquis élevé
Vous voilà à l’ombre de deux grands arbustes typiques des sols acides qui constituent le « maquis élevé » : l’arbousier au tronc rouge, un des rares végétaux à porter en même temps, à la fin de l’automne, des fleurs blanches en clochettes et des baies rouge-orangées à la saveur fade, et la bruyère arborescente, aux petites feuilles en aiguilles.
Ces deux plantes font partie de la famille botanique des Ericacées.
Autrefois, les villageois faisaient commerce des souches rondes de bruyère comme bois de feu (il se consume très lentement) ou de sculpture, notamment pour la fabrication de pipes.
A droite du sentier : le muret en pierres sèches marque l’emplacement d’anciennes « restanques », c’est-à-dire de cultures en terrasses, plus économes en espace, en eau et en terre.
Elles recouvraient une grande partie de Port-Cros, il y a moins d’un siècle ; difficile d’imaginer que ces vallons ont pu produire orges et blés, figues et kakis, oranges et grenades !
Végétation couchée part le vent - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 9 - Le couloir des courants d'air
La vie au bord de la mer n’a pas que des avantages ! Hormis quelques plantes très spécialisées qui tolèrent bien la morsure du sel et la force du vent, s’accrocher au rocher est un défi permanent.
Certaines plantes qui y parviennent prennent des formes « anémo-morphosées » (littéralement : transformées par le vent), couchées, torturées, plaquées au sol. C’est un phénomène que l’on retrouve dans d’autres milieux extrêmes, comme les montagnes ou les toundras.
Ici, la circulation du vent chargé d’eau salée a fini par ouvrir la masse végétale, créant un véritable couloir d’embruns. Ce type d’ouverture s’avère lent à cicatriser, d’autant qu’à l’heure actuelle s’ajoutent les contraintes des eaux polluées par les détergents et les hydrocarbures, du piétinement par les
promeneurs et des charges en nitrate apportées par certains oiseaux marins; on peut citer notamment les goélands dont les fientes modifient les sols.
Clématite flammette - Marie-Claire Gomez Flore terrestreStation 10 - La course à la lumière
Pour survivre, les plantes se nourrissent par les racines en allant puiser dans le sol l’eau et les sels minéraux et en se hissant vers le haut pour capter la lumière qui va activer la photosynthèse.
Sur les sols riches, profonds et humides de certains fonds de vallon, les végétaux se livrent une lutte sévère pour conquérir ces milieux accueillants.
Deux stratégies s’affrontent pour gagner la course vers le soleil. Les arbres qui ont pu s’élever grâce à la rigidité de leur bois semblent les mieux placés, mais les lianes se distinguent par une autre méthode : elles ont choisi d’allonger leur tige pour grimper à l’assaut des arbres.
Cinq espèces différentes (au moins !) s’entortillent autour de vous ; ouvrez l’œil !
Il y a la clématite flammette, l'asperge sauvage, la salsepareille, le chèvrefeuille mais aussi la ronce bien connue.
Ces zones ombragées sont aussi le domaine de prédilection du fragon petit houx, du petit arum et des fougères.
Pin d'alep penché vers la mer - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 11 - Une lutte sans merci
Dans le virage qui suit, deux espèces témoignent de la lutte lente mais sans merci pour l’occupation de l’île. Les plus grands, qui dominent tous les autres, sont des pins d’Alep. Ce sont des plantes pionnières qui occupent le terrain lorsque celui-ci est encore vierge de toute végétation élevée : les jeunes pins ont besoin de beaucoup de lumière pour se développer (ce sont des plantes « héliophiles », « qui aiment le soleil »). Plus tard, à l’ombre de leur couvert, s’installent les chênes verts.
Les pins d’Alep n’ont pas une espérance de vie très longue (environ 150 ans) et lorsqu’ils disparaissent, il est impossible pour eux de se réinstaller car les chênes verts qui se sont développés dispensent une ombre épaisse.
Barbe de Jupiter - Caroline Devevey Flore terrestreStation 12 - Les fleurs du sel
Non loin de la mer, la roche affleure et les embruns arrosent la végétation.
Les plantes, pour se protéger du sel, adoptent différents systèmes de défense : L’immortelle, la cinéraire maritime ou encore la barbe de Jupiter dont les buissons gris évoquent la barbe du dieu romain, ont les feuilles revêtues d’un duvet soyeux et argenté.
La criste marine ou fenouil de mer a des feuilles charnues vernissées.
La statice naine prend une forme de coussinet touffu.
Toutes ces plantes résistent au vent et aux embruns : ce sont des plantes « halo-résistantes ».
Tamaris d'Afrique - Christel Gérardin - Parc national de Port-Cros Flore terrestreStation 13 - La plage de la Palud
Les arbres en front de mer sont des tamaris. Vivant habituellement en arrière-plage, ils sont victimes du recul de celle-ci. Ils peuvent vivre en absorbant de l’eau plus ou moins salée, car lors de leur transpiration nocturne ils rejettent par leurs feuilles le sel accumulé pendant la journée.
Afin de retenir le sable et pour préserver les fourrés de tamaris très menacés, des zones ont été « mises en défens ». Observez le retour de la végétation dans les secteurs protégés, autrefois dénudés par un piétinement excessif.
La posidonie n’est pas une algue mais une plante, constituée de racines, de tiges rampantes ou dressées (rhizomes), de feuilles, et qui fleurit et fructifie. Elle forme de vastes prairies sous-marines qui jouent le même rôle en mer que la forêt sur terre (oxygène, abri, nurserie, habitat pour de nombreuses espèces…).
Sur le rivage, un tapis de feuilles de posidonie recouvre le sable d’une moelleuse protection. La posidonie n’est pas une algue, c’est une plante à fleurs qui forme sous la surface une vraie prairie sous-marine. Elle est vitale pour de nombreuses espèces marines mais aussi terrestres.
Sur la plage, les feuilles mortes formant banquettes, abritent des insectes rares, permettent l’installation de plantes et protègent de l’érosion.
Le sentier sous-marin est accessible aux beaux jours et offre un parcours balisé de découverte de la faune et de la flore marines.
Description
Depuis la Maison de Parc, descendre les escaliers, longer le Bureau de Poste puis prendre à gauche et monter vers le fort du Moulin (qui ne se visite pas). Passer au pied de la tour et du rempart.
- En face du pont-levis, prendre le sentier à droite qui débute par deux petites marches. Possibilité de contourner le fort par la gauche. Superbes points de vue sur la rade de Port-Cros et l’îlot de Bagaud. Quelques dizaines de mètres plus loin se présente le petit cimetière marin. Emprunter le sentier le plus à gauche. Quelques petites grimpettes permettent de se chauffer les mollets, mais fort heureusement, la majeure partie du sentier est ombragée. De petites plaques numérotées présentent les principales plantes caractéristiques de la végétation de l’île (voir brochure « sentier des Plantes »).
- Environ 15 minutes plus tard au détour d’une boucle, on découvre soudain, en contrebas, l’îlot du Rascas et la plage de la Palud, où se situe le sentier sous-marin. Au loin, se profilent la pointe de la Galère et derrière, l’île du Levant.
- Un peu après la bifurcation vers le fort de l’Estissac, prendre à gauche le sentier qui descend, (nombreux escaliers) avant de pénétrer dans la forêt littorale.
- A la plage de la Palud, traverser la plage. Avant les escaliers, tourner à droite sur le sentier en direction du Vallon Noir et de la Route des Forts.
- Tourner à droite sur la Route des Forts qui permet de rejoindre le village de Port-Cros.
- Départ : Maison de Parc de Port-Cros
- Arrivée : Plage de la Palud
- Communes traversées : Hyères
Météo
Profil altimétrique
Recommandations
Le jour de votre départ sur l'île, veillez à vous informer sur le risque incendie mis à jour quotidiennement en période estivale sur le site de la préfecture (https://www.risque-prevention-incendie.fr/var/).
En fonction des niveaux de risque incendie, les massifs forestiers peuvent être fermés au public.
En fonction des niveaux de risque incendie, les massifs forestiers peuvent être fermés au public.
En coeur de Parc
Le Parc national est un territoire naturel, ouvert à tous, mais soumis à une réglementation qu’il est utile de connaître pour préparer son séjour : https://www.portcros-parcnational.fr/fr/le-parc-national-de-port-cros/se-renseigner-sur-les-reglementations


Risque incendie
De juin à septembre, l'accès aux massifs forestiers est réglementé.
Pour connaître les conditions d’accès et préparer votre sortie, consultez la carte publiée quotidiennement par la Préfecture du Var sur www.risque-prevention-incendie.fr/var
La cigarette est strictement interdite sur les îles, les plages et les sentiers. Tout contrevenant encoure une amende de 135 à 1500 €.
Transport
Ligne de bus 67 (Hyères Centre - Tour Fondue)
Arrêt "Port la Gavine"
Pour consulter les horaires : https://www.reseaumistral.com
Accès routiers et parkings
Accès uniquement par bateau.
Plus de détails dans la rubrique du site du parc : "Venir dans le Parc national de Port-Cros"
Plus de détails dans la rubrique du site du parc : "Venir dans le Parc national de Port-Cros"
Stationnement :
Parking Arromanche ; Parking du quai des pêcheurs ; Parking de l’hippodrome
En savoir plus
Signaler un problème ou une erreur
Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :
À proximité5
- Sorties et sites de découverte
- Sorties et sites de découverte