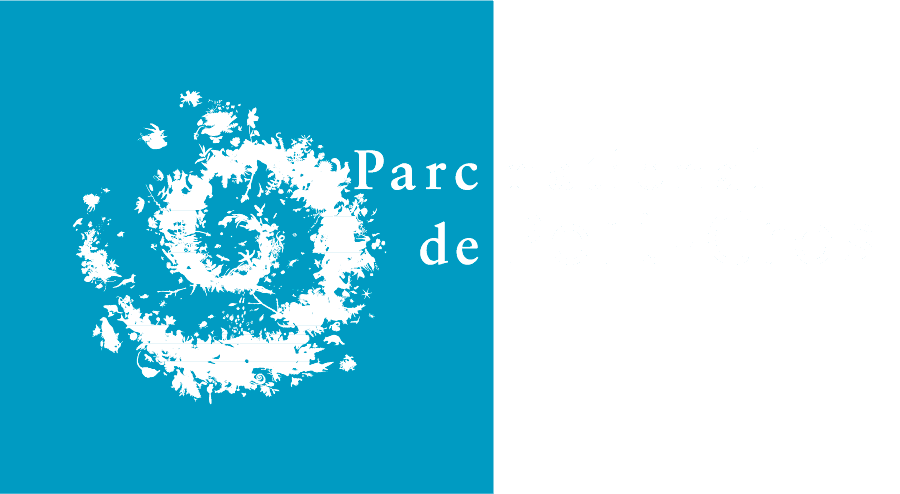Port-Cros - Circuit des forts
Les 5 patrimoines à découvrir

Fort du Moulin - Jm.Prieur-PN-Port-Cros Patrimoine fortifiéFort du Moulin
Le fort du Moulin domine le port et occupe une position stratégique qui lui permet de veiller au danger venant de la mer.
Edifié sous François 1er en 1531, il est le plus ancien et le plus grand fort de l’île. Le fort est restauré puis remanié en 1634 à la demande de Richelieu qui souhaite réorganiser la défense des îles. Le fort connaîtra ensuite de nombreuses modifications, notamment après sa destruction par les Anglais en 1793.
Il est à l’origine d’œuvres littéraires comme Jean d’Agrève (E.M de Vogüé, 1897) et La voie sans retour (H. Bordeaux, 1902). Dans les années 1920, les écrivains Jules Supervielle, Henri Michaux et Saint-John Perse y résident régulièrement.
Seul monument de l'île à être classé "monument historique", il est dorénavant fermé au public.
Fort de Port-Man - Christel Gérardin_PN de Port-Cros Patrimoine fortifiéFort de Port-Man
Situé à l’extrémité Est de l’île, le fort domine la baie de Port-Man et la passe des Grottes, entre Port-Cros et Le Levant. Construit sous Richelieu, il s’uni parfaitement au promontoire rocheux étroit sur lequel il se trouve. Jusqu’à son désarmement en 1881, il subit de multiples restaurations mais sous l’action corrosive de l’air marin, il continue à se dégrader fortement. Devant l’importance des restaurations à effectuer, le Parc national de Port-Cros le concède par bail emphytéotique de 40 ans au photographe Yann Arthus-Bertrand qui le restaure ensuite avec succès en 2009.

Fort de La Vigie - © Muriel Gasquy - PnPC Patrimoine fortifiéFortin de la Vigie
Construit en 1810 sous Napoléon, le Fort de la Vigie se situe à 199m sur l’un des points culminants de l’île de Port-Cros. Des quatre fortifications que compte l’île, elle est la seule qui soit encore en activité. Actuellement occupé par la Direction Générale de l’Armement, le fort a également accueillit les auteurs de la Nouvelle Revue Française. En effet, en 1925 Jean Paulhan, écrivain, éditeur et animateur de la NRF rencontre Marcel et Marceline Henry, propriétaires de l’île. L’occasion est trouvée alors que Jean Paulhan, de retour d’une excursion dans l’île, cherche à rapiécer son pantalon déchiré. C’est auprès de Marceline Henry qu’il trouve secours et noue avec elle une amitié durable. Les Henry céderont le Fort de la Vigie aux auteurs de la NRF qui l’occuperont jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Propriété de la Marine Nationale, il est désormais fermé au public.

Fort de l'Eminence - Christel Gérardin_PN de Port-Cros Patrimoine fortifiéFort de l'Eminence
Remarquable par ses dimensions et son architecture, le fort de l’Éminence complète le dispositif de défense de l’île, notamment de la rade de Port-Cros.
Les trois ouvrages, échelonnés en hauteur sur la même crête, forment un groupement tactique intentionnel, où le fort du Moulin tient lieu de batterie côtière et d’ouvrage de protection du port de Port-Cros, couvert par l’Estissac, lui-même dominé par l’Éminence, ouvrage de surveillance du système.
Les huit ouvertures de la façade Sud-Ouest, correspondent à huit casemates, dont l’une a été éventrée par un obus.
Elles donnent sur une cour centrale d’où partent de nombreux couloirs desservant les bastions.
Le fort actuel s’élève à l’emplacement d’un premier fortin - tour à construit sous Richelieu vers 1635-1640. Celui-ci fut détruit par les Anglais en 1793. La reconstruction d’un nouvel ouvrage de style Vauban ne débuta qu’en 1812, mais cessa à la chute de l’Empire en 1814, pour ne reprendre qu’en 1863 jusqu’en 1876. Il resta en service actif jusqu’en 1914. Les progrès de l’artillerie ont alors rendu inefficaces les lourdes masses de terre dont il était enrobé. L’ouvrage porte les stigmates des attaques allemandes et du bombardement naval allié d’août 1944, lors de la préparation du débarquement en Provence.
Fort de l'Estissac - Lison Guilbaud_PN de Port-Cros Patrimoine fortifiéFort de l'Estissac
Situé sur la crête Nord principale de l’île, le fort de l'Estissac offre un magnifique panorama sur la rade d’Hyères.
Edifié sous Richelieu en 1635, les Anglais le détruisent en 1793 pendant la révolution Française. Le fort est reconstruit et agrandit en 1810 avec l’ajout d’un corps d’habitation. Il est finalement restauré et devient un lieu d’exposition après son affectation au Parc National de Port-Cros au 20ème siècle.
L'ouvrage est composé d'une tour à canons cylindriques à deux niveaux. La tour était à l'origine circulaire et présente une forme tronquée aujourd'hui. Le toit de la tour est construit en forme d'impluvium afin de récupérer l'eau de pluie qui était acheminée jusqu'à la citerne située en dessous.
Le nom du fort vient du premier commandant, le baron de l'Estissac.
Description
- A partir de la Maison de Parc, descendre les escaliers et tourner à gauche après le bureau de poste, en direction du fort du Moulin.
- Contourner le fort du Moulin. En face du pont-levis, prendre le chemin qui part en direction de la plage de la Palud.
- Possibilité de choisir entre la variante "Plage de la Palud par le sentier des plantes" ou de rester sur le sentier principal.
- A la Plage de la Palud, traverser la plage puis monter les escaliers qui se trouvent au bout. Continuer sur le chemin.
- Après un kilomètre environ, continuer sur le sentier qui tourne légèrement à gauche, direction "Port Man par la Galère". Continuer jusqu'à la Pointe de la Galère puis longer la baie de Port Man.
- Suivre la direction "Plage de Port Man". Traverser la plage puis rejoindre la route et prendre à gauche, vers le fort de Port Man.
- Aller au fort de Port Man puis revenir sur ses pas. Au panneau, continuer tout droit sur la route pendant environ trois kilomètres, en direction de la Sardinière / le village.
- A la Sardinière, prendre le petit sentier qui part sur la droite, en direction du fortin de la Vigie.
- Au fortin de la Vigie, redescendre la route des forts qui mène jusqu'au village, en passant par le fort de l'Eminence et de l'Estissac.
- Départ : Maison de Parc de Port-Cros
- Arrivée : Maison de Parc de Port-Cros
- Communes traversées : Hyères
Météo
Profil altimétrique
Recommandations
En fonction des niveaux de risque incendie, les massifs forestiers peuvent être fermés au public.

Lieux de renseignement
Capitainerie de Port-Cros
Le port Port-Cros, 83400 Hyères
Horaires d'ouverture :
Du 01/04 au 31/10 : 8h00-18h (coupure méridienne variable)
Maison de Parc de Port-Cros
Promenade de la Rade, 83400 Hyères
Elle comprend par ailleurs une boutique de souvenirs.
Horaires d'ouverture :
Du 01/04 au 31/10/2021 : tous les jours 9h-12h45 et 15h30-17h30.
Transport
Ligne de bus 67 (Hyères Centre - Tour Fondue)
Arrêt "Port la Gavine"
Pour consulter les horaires : https://www.reseaumistral.com
Accès routiers et parkings
Plus de détails dans la rubrique du site du parc : "Venir dans le Parc national de Port-Cros"
Stationnement :
Signaler un problème ou une erreur
Vous avez repéré une erreur sur cette page ou constaté un problème lors de votre randonnée, signalez-les nous ici :
À proximité5
- Sorties et sites de découverte
- Sorties et sites de découverte